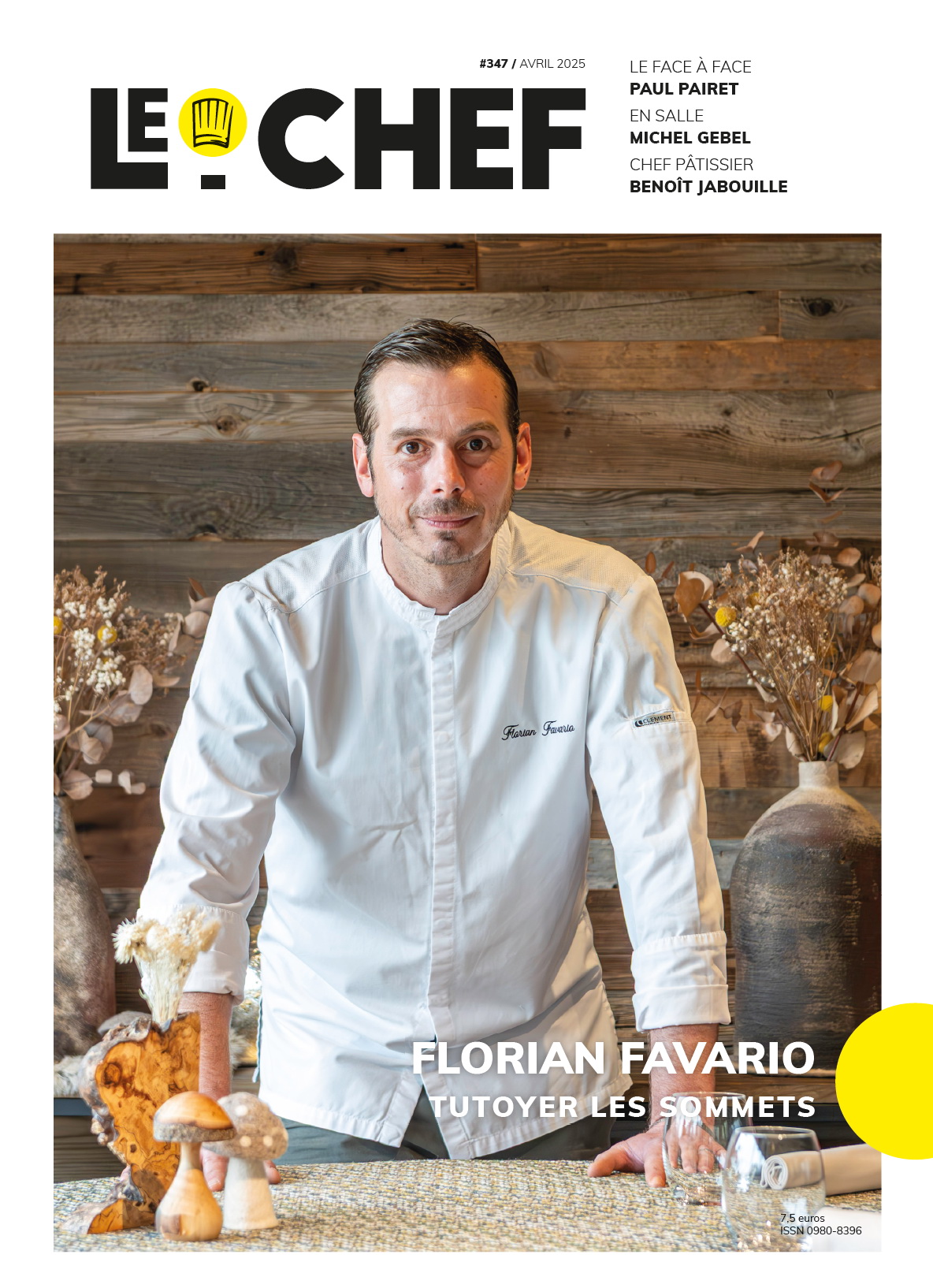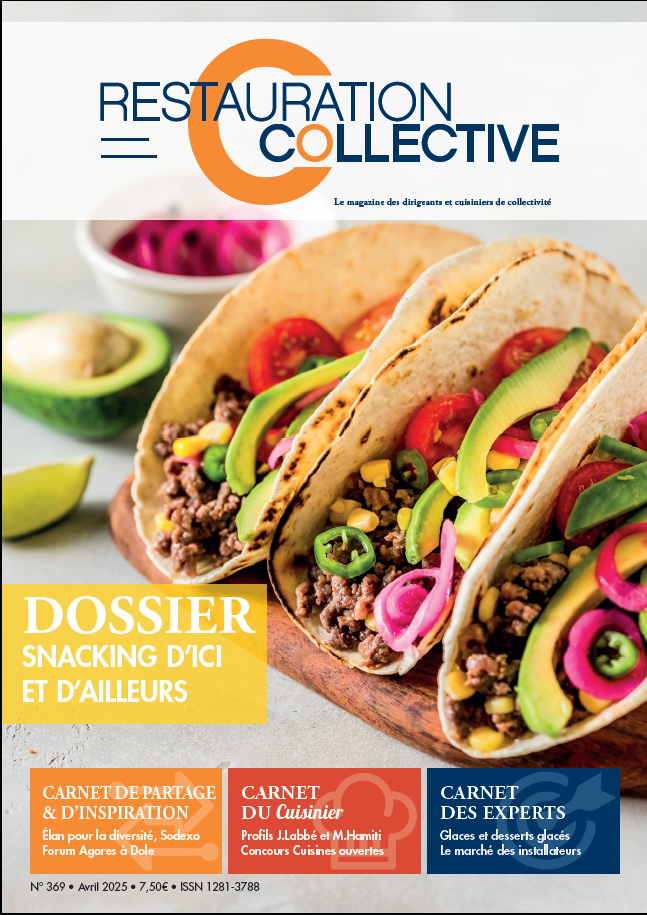Selon une enquête récente du Crédoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie), avant les années 1970, les personnes gravement malades et en fin de vie étaient plus souvent prises en charge à domicile. Mais les lieux de fin de vie se sont progressivement déplacés du domicile aux établissements médicaux. D’où le développement des soins palliatifs, en France, dans les années 1970, d’abord sous l’impulsion du milieu associatif, puis institutionnel. Les soins palliatifs sont pratiqués au domicile du patient ou en institution. A domicile, ces soins mobilisent les compétences d’une équipe de soins traditionnels et celles des services d’hospitalisation à domicile (HAD). Ils peuvent aussi être dispensés dans un établissement traditionnel, avec l’intervention d’une équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) ou dans une Unité hospitalière de soins palliatifs (USP). «Malgré un développement important des soins palliatifs depuis 1999, le nombre de professionnels et de structures est encore insuffisant», note le Crédoc. «Selon la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, on estime qu’il existe en France, au début de l’année 2003, 225 équipes mobiles, 78 unités de soins palliatifs et une moyenne de 10 lits par unité. Or, on évalue entre 150 000 et 200 000 le nombre de personnes ayant besoin de soins palliatifs en France.» Ils en ont besoin et théoriquement, selon la loi, ils y ont droit. En effet, la loi du 9 juin 1999 prévoit que «toute personne malade dont l’état le
Il reste 14% de l’article à lire
Pas encore abonné ? Abonnez-vous !
Vous êtes abonné ? Connectez-vous
Accédez à l’ensemble des articles de Restauration Collective à partir de 64€
S'abonner